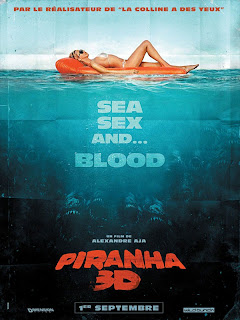L’Etrange Festival se déroulait la semaine dernière au Forum des Images de Paris. Cette sélection de films remarquables par leur originalité et/ou leur extrémisme permet d’ouvrir un maximum le spectre des possibles qu’offre le cinéma et on ressort forcément grandi d’une semaine comme celle que je viens de vivre. Pour ceux qui auraient manqué cet événement délicieux, voici mon palmarès personnel de la sélection 2010, tout du moins des films que j’ai eu l’occasion de voir (ce qui explique l’absence de Monsters ou A Serbian Film notamment). J’encourage chaudement quiconque lit ces lignes à aller voir (ou se procurer, pour ceux qui ne sortiront pas en France) un maximum de ces films, en commençant par le haut (et en s’arrêtant au cinquième, idéalement).
1. Rubber de Quentin Dupieux
Avec Stephen Spinella, Roxane Mesquida, Jack Plotnick
Il arrive souvent que l’on attende un film depuis si longtemps qu’on ne peut s’empêcher d’en avoir des espérances inatteignables. On ressort alors de la salle déçu, presque triste, voire en colère. Pour Rubber ce ne fut pas du tout le cas, bien au contraire. Je m’attendais à ce qui était annoncé, une histoire de pneu télékinésiste et légèrement psychopathe, un film de genre complètement barge, à l’image des précédents de Quentin Dupieux. Oui Rubber c’est d’abord ça, une mise en scène qui parvient à rendre un pneu vivant, émotif, inquiétant, une photo parfaite, des acteurs immenses. Mais ce qu’on ne m’avait pas annoncé c’est toute la partie immergée de l’iceberg, qui est colossale. Au delà de l’histoire du pneu vient se greffer toute une structure intermédiaire. On suit les aventures du public venu voir un film au milieu du désert (celui du pneu), et qui le suit au moyen de jumelles optiques. Les deux histoires s’entrecroisent et nous offrent un délice de comédie absurde, rappelant les meilleures heures du cinéma de Buñuel période « charme discret ». Mais j’y consacrerai probablement un article entier lors de la sortie en salles du film (10 novembre) tant il y a de choses à en dire.
2. The immaculate conception of Little Dizzle de David Russo
Avec Marshall Allman, Natasha Lyonne, Sean Nelson
L’un des films qui rend le plus grâce au nom du festival qui l’accueille. Etrange effectivement, cette histoire de techniciens de surface se gavant de gâteaux hallucinogènes trouvés dans les poubelles de leurs employeurs. Difficile de résumer plus en détail ce film, on pourrait le synthétiser en disant qu’il est une sorte de mixture regroupant le charme indie des frères Safdie, les dialogues ciselés du meilleur Kevin Smith, les délires hallucinés de Gregg Araki et la folie scénaristique de Charlie Kaufman. Original, forcément, mais surtout drôle de bout en bout. Un film tellement étrange que j’ai bien peur de ne pas pouvoir le revoir en salle de sitôt (pas de date de sortie française prévue).
3. Buried de Rodrigo Cortés
Avec Ryan Reynolds
« Tu crois vraiment que tout le film va se passer dans le cercueil ? Ha ha ». On me riait au nez quand j’essayais d’imaginer Buried avant d’aller le voir en salle. Cette histoire d’un camionneur en mission en Irak qui se réveille six pieds sous terre avec pour seule compagnie un briquet et un téléphone portable. Eh bien oui monsieur, pas un seul plan du film ne se déroule hors du cercueil, et c’est là que Buried est exceptionnel. Le dernier cinéaste à avoir tenté une telle prouesse est Joel Schumacher, avec son excellent Phone Game, qui parvenait à nous tenir en haleine pendant 80 minutes. Dans Buried, en l’espace d’1h35, l’espagnol Rodrigo Cortés ne nous laisse pas une seconde pour respirer. Le moindre coup de fil passé prend aussitôt une charge dramatique immense, grâce à une mise en scène inventive et efficace. Un coup de maître. Sortie en salles le 3 novembre.
4. Pontypool de Bruce McDonald
Avec Stephen McHattie, Lisa Houle, Georgina Reilly
Autre film à concept, à l’image de Buried. Grant Mazzy, animateur de radio libre, reçoit des appels de gens paniqués, racontant des émeutes assorties de faits divers étranges. Grant, sa standardiste et sa productrice commencent à flipper eux aussi. Canular ou réalité ? La question se pose aussi pour le spectateur. Bruce McDonald parvient à nous emmener où il veut grâce à son excellent travail sur l’image et le son, et arrive à faire de nous des victimes au même titre que ses protagonistes principaux face à une énigme dont seul le générique final nous donnera des éléments de réponse. Un objet cinématographique déroutant, à voir par curiosité, en DVD (pas de sortie ciné prévue).
5. Bedevilled de Cheol So Jang
Avec Young-hee Seo, Sung-won Ji Seo, Min-ho Hwang
Victime de surmenage, Hae-won prend des vacances dans l’île où elle a grandi, au fin-fond de la Corée. Elle y retrouve une amie d’enfance, Bok-nam, qui n’a jamais quitté l’île et est visiblement malmenée par les habitants. Hae-won, troublée, ne sait pas comment réagir. Cheol So Jang parvient à installer une tension croissante pendant une bonne moitié de film avant de balancer la purée dans un final sordide et ultra-gore. En passant, il amorce une réflexion sur la culpabilité et la question de comment réagir face à l’humiliation d’autrui, dans un film plutôt réussi mais assez incommodant.
6. The Housemaid de Im Sang-Soo
Avec Jeon Do-Yeon, Lee Jung-jae, Youn Yuh-jung
Note : On entre dans la deuxième partie du top, à partir de maintenant ce sont des films que je ne conseille pas. Euny est embauchée comme gouvernante dans une famille bourgeoise. Elle entretient une relation avec le père de famille et tombe enceinte. Bad trip. Très beau pendant une heure, The Housemaid ne parvient pas à tenir la distance et se perd dans un gouffre mélodramatique menant tout droit à une fin d’un grotesque achevé. Sortie le 15 septembre.
7. Le dernier exorcisme de Daniel Stamm
Avec Patrick Fabian, Ashley Bell, Iris Bahr
Cotton Marcus est suivi par une chaîne de télévision pour révéler à l’Amérique que tout son passé d’exorciste n’était qu’une vaste supercherie, mais voilà qu’il se retrouve en présence d’un vrai cas de possession démoniaque. L’idée de départ est bonne, et d’ailleurs le film est drôle pendant une bonne demi-heure quand on voit Cotton raconter sa vie, se déplacer avec l’équipe du documentaire, puis pratiquer un exorcisme pipoté en dévoilant ses trucs en montage alterné. L’idée du faux documentaire est là parfaitement justifiée. Mais quand on bascule dans le film d’horreur, le procédé, déjà usé par Blair Witch, Cloverfield ou Rec devient inutile, voire pesant, d’autant que Daniel Stamm ne lui apporte aucun renouveau. On n’a jamais peur et cette histoire vraiment trop bateau ne suscite pas le moindre intérêt. Au final, les seuls sursauts provoqués le seront grâce à une musique criarde, qui n’a dans le cadre du faux documentaire aucune légitimité. Sortie le 15 septembre.
8. Four Lions de Chris Morris
Avec Riz Ahmed, Arsher Ali, Nigel Lindsay
Four Lions raconte l’histoire de quatre djihadistes anglais complètement idiots, obsédés par l’idée de se faire exploser. Evidemment, c’est original, diablement osé même, de tourner en dérision un tel sujet. Le seul problème (et il est énorme) c’est que la stupidité des protagonistes est telle qu’elle en devient inconcevable et ne parvient à provoquer que les sourires polis. On se remet alors à quelques situations cocasses pour trouver de quoi rire mais elles ne sont pas si fréquentes et on regrette à la fin que tous ces gags rocambolesques semblent avoir été écrits sans le moindre souci de vraisemblance. Sortie le 8 décembre.
9. Proie de Antoine Blossier
Avec Grégoire Colin, Bérénice Béjo, François Levantal
Une vague histoire de sangliers mutants dans la cambrousse, un film d’horreur français, pas terrible. Ce n’est pas très bien filmé, pas très subtil, et on ne voit pas grand chose (pratiquement tout le film se passe de nuit) et c’est peut-être heureux car les effets spéciaux sont gravement cheapos. Pas de date de sortie prévue mais je ne pense pas qu’il soit indispensable d’aller le voir.
Pas de vidéo mais une belle image.
10. Nous sommes ce que nous sommes de Jorge Grau
Avec Francisco Barreiro, Alan Chavez, Juan Carlos Colombo
On nous promettait un Morse version antropophage transposé au Mexique, mais ce film (présenté à Cannes en mai dernier) ne tient pas une seconde la comparaison. Cette histoire d’une famille de cannibales livrée à elle-même après la mort du père ne se situe ni dans le registre de la métaphore sociétale, ni dans celui du film de genre rigolard. C’est sinistre, pesant, pas drôle (cela dit, ça ne cherche pas à l’être), on ne comprend rien et on se fait chier.