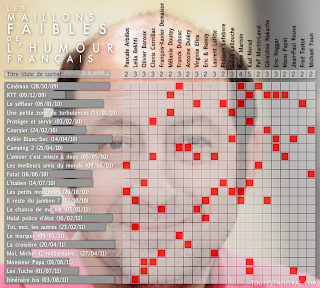A l’heure où l’on vient de nommer cinq des plus mauvais films de l’année dans la catégorie Meilleure comédie des Golden Globes (j’exagère À PEINE), j’ai décidé (un peu inconsciemment) que la coupe était pleine et qu’il était temps de rendre hommage au vrai cinéma comique bien de chez nous, celui de Gérard Oury, Claude Zidi et autres Francis Veber.
Après mon petit laïus d’il y a quinze jours sur l’excellente autobiographie de ce dernier, j’ai maintenant envie de m’atteler à un autre gros dossier. Car que seraient tous ces gens-là sans l’apport incontournable de Vladimir Cosma, compositeur d’origine roumaine bi-césarisé, une fois pour la BO de Diva de Jean-Jacques Beineix, l’autre pour Le Bal d’Ettore Scola ? Je vous le demande.
D’ailleurs ce n’est pas de ces oeuvres-là dont je veux parler. Pas même de Reality, chanson-phare de La Boum, et encore moins de la non moins mythique chanson de Guy Marchand, Destinée, dont Cosma est le compositeur. Car là où Vlad a excellé en silence, sans recevoir jamais une seule récompense digne de ce nom, c’est dans la musique de comédie, y incorporant à chaque fois sa touche personnelle, une flûte de pan, un cymbalum ou un joyeux pipeau ; une audace constante qui fait de lui, non je n’ai pas peur de le dire, une sorte d’Ennio Morricone français. Oui madame.
1. L’aile ou la cuisse
Voilà un morceau qui synthétise parfaitement tout l’art de Vladimir Cosma. Ça commence comme un Te Deum de Charpentier, mais cette effusion classique est bien vite oubliée avec cette succession d’anachronismes à la fois ridicules et fabuleux, à base de voix féminines, de lignes de basse minimalistes et de hi-hats batifolants. Un ensemble génialement grotesque qui sied bien au film qu’il illustre, ce chef-d’oeuvre de Claude Zidi incarné par Coluche et Louis de Funès.
2. Clérambard
Avant d’illustrer une insupportable pub Ricoré de 2004, ce morceau intitulé Les demoiselles de province figurait dans la bande originale de Clérambard, un film d’Yves Robert avec Philippe Noiret (1969). Mais écoutez de plus près la finesse de l’arrangement, cette mélodie jouée par ce que je pense être une variété de kazoos, posée sur une basse funky, un beat énergique et un accompagnement cuivré tout à fait dans le style de ce qui se faisait dans les films de gangsters italiens à la même époque (Morricone tout ça).
3. Le Placard
Bon, Le Placard, on aime ou on n’aime pas le film (moi j’aime) mais il faut quand même admettre que ce thème principal est proche de la perfection, et aurait très bien pu accompagner un film de Fellini sans qu’on fasse la différence avec son compositeur habituel, Nino Rota (qui est une de mes idoles, soit dit en passant). J’ai créé un compte soundcloud rien que pour ce morceau, faites-lui honneur.
4. Le dîner de cons
On a tendance à l’oublier mais s’il est vrai que le scénario du Dîner de cons a quelque chose d’éblouissant, au même titre que la performance de ses acteurs, c’est aussi le cas de sa bande originale. Il semble que Vladimir Cosma ait vécu à la fin du XXe siècle une sorte de révélation reinhardtienne car sa composition pour le Dîner de cons dénote d’influences manouches aussi impromptues que surprenantes, maîtrisées à la perfection (retrouvées plus tard dans différents titres de la BO du Placard d’ailleurs). Mais l’adepte du mélange de styles qu’est notre ami Vlad ne s’arrête pas là et balance une orchestration classique du plus bel effet. Et ça donne ça :
5. Les aventures de Rabbi Jacob
Là encore tout y est, la basse délicatement slappée, les cuivres, les cordes, les voix, et la mélodie qui claque. C’est tout.
6. Les compères
En 1983, Vladimir Cosma avait déjà un peu tout fait. Mais pas encore un thème principal siffloté comme quand on va à la pêche entre potes. C’était parfait pour Les Compères, encore un excellent film de Francis Veber. D’ailleurs si tu z’aimes les musiques de films avec un mec qui siffle dedans, tu peux aussi consulter ce top 10 spécial « thèmes de films avec un mec qui siffle dedans ».
7. Banzai
Je ne sais pas si Vladimir Cosma s’est drogué dans sa vie, mais s’il l’a fait, je pense qu’il a composé cette BO dans un sacré trip. C’est donc une sorte d’hymne funky accentuée de scintillements japanisants et de scansions vigoureuses qu’il offre à Claude Zidi pour son film Banzai, en n’oubliant pas les curieux solos de violon ou de flûte orientale qui jalonnent le morceau. Sinon le film était marrant, un peu.
8. La chèvre
Comme dirait Vincent Perrot, une musique peut ressembler à un acteur. C’est pour ça que désormais, chaque fois que j’entends une flûte de pan, je ne peux m’empêcher de penser au visage jovial et épanoui de Pierre Richard dans La Chèvre, excellentissime film de Francis Veber.
9. Inspecteur La Bavure
Je n’ai pas grand chose à dire sur la BO de cette oeuvre de Claude Zidi (encore lui), donc je vais plutôt parler du film, que je n’ai pas vu depuis longtemps d’ailleurs ; mais je me souviens très bien qu’au début Depardieu est brun et il a une moustache et comme c’est un méchant il change de visage pour ne pas se faire griller et devient le Depardieu avec la tête que l’on connaît (blond et sans moustache) et personne ne le reconnaît alors que quand même la différence est assez faible. Et sinon il y a aussi Coluche dans le film. Film sympa, au demeurant.
10. Le grand blond avec une chaussure noire
Celle-là je trouve que tout le monde l’a assez entendue mais je l’aime quand même. Je conseillerais néanmoins à mes chers lecteurs de jeter une oreille du côté des bandes originales du Jouet, du Distrait, de Je suis timide mais je me soigne… Ou mieux, de s’acheter le coffret en deux volumes (bientôt 3) de l’intégrale des BO de Vladimir Cosma. Ou mieux, de me l’offrir pour Noël. Vous ne le regretterez pas.