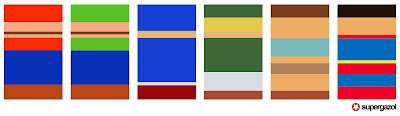Jake (Steven R. McQueen) habite dans une région de rêve, au bord d’un lac paradisiaque. Quand un réalisateur de porno (Jerry O’Connell) l’invite à le rejoindre sur son yacht rempli de jeunes femmes à la plastique parfaite pour les guider sur le lac, il profite de l’occasion pour sortir de son quotidien morose de post-ado timide et emprunté. Manque de pot, des piranhas sortis de nulle part bouffent tout sur leur passage.
Tel est le pitch plutôt banal de Piranha. La façon dont il a été traité par Alexandre Aja l’est moins. Car comme une sorte de Pasolini des temps modernes, le frenchy a visiblement choisi de scinder son film en deux parties distinctes, le cycle du nichon et le cycle de la viande rouge. Le prétexte du tournage de film porno est l’occasion de montrer à chaque plan une paire de gros seins comprimés dans un soutif rouge pétant ou ballottant au ralenti dans l’eau bleue du lagon, et cela pendant une bonne demi-heure. Toujours avec une certaine distanciation humoristique plutôt appréciable.
Dans la seconde partie du film en revanche, ce côté charnel est totalement délaissé pour laisser place à des scènes bien plus trash. Et là tout est prétexte à du gore bien craspouille, non seulement les piranhas (particulièrement voraces) s’en donnent à coeur joie, mais de tristes individus ne ménageant pas leurs congénères pour sauver leur peau, sans oublier les éléments du décors invraisemblablement dangereux sont autant de dommages collatéraux bien ballots et bien rigolos que l’on nous donne à voir avec une certaine jouissance (mourir coupé en deux par un câble électrique c’est quand même pas de chance). Zéro suspense, zéro angoisse, que du gore, rien n’est suggéré, tout est montré, et au bout d’un certain moment on ne compte plus les corps moitié-chair moitié-squelette ressortis de l’eau par des sauveteurs effarés.
Ces deux parties distinctes s’emboîtent finalement plutôt bien mais le ton du film a tendance à virer premier degré au fil des minutes. La construction très classique de l’intrigue n’est pas là pour apporter un peu de fantaisie et sans le personnage du réalisateur porno ou celui du scientifique échevelé joué admirablement par Christopher Lloyd on pourrait très bien considérer le scénario de Piranha comme celui du pire film de l’année. Ce qui sauve le film, c’est cette outrance, ce culot qui fait que l’on ne craint pas de montrer en gros plan un poisson très méchant ne faire qu’une bouchée d’un gros kiki esseulé, ou de citer directement Braindead en déchiquetant du piranha avec une hélice de hors-bord.
Du point de vue visuel, c’est plutôt laid, disons-le. Les piranhas sont assez mal synthétisés et les scènes de festin sont assez troubles pour qu’on ne puisse pas voir la faiblesse technique des images. Pour ce qui est de la 3D, elle est absolument inutile. On remarque bien les tentatives du réalisateur d’incorporer des éléments troidéisables dans ses séquences, mais ce n’est guère convaincant et les gouttes d’un vomi craché en contre plongée, a priori le clou du spectacle, n’arrivent même pas à atteindre le dixième du chemin parcouru par la célèbre fraise Tagada d’avant-film.
Au delà de ses quelques guests sympas (Richard Dreyfuss, Elisabeth Shue, Christopher Lloyd, Ving Rhames, Eli Roth), Piranha brille donc par son sens de l’humour et du gore sans concession. Beaucoup moins par son scénario et sa réalisation technique. Avis aux amateurs.